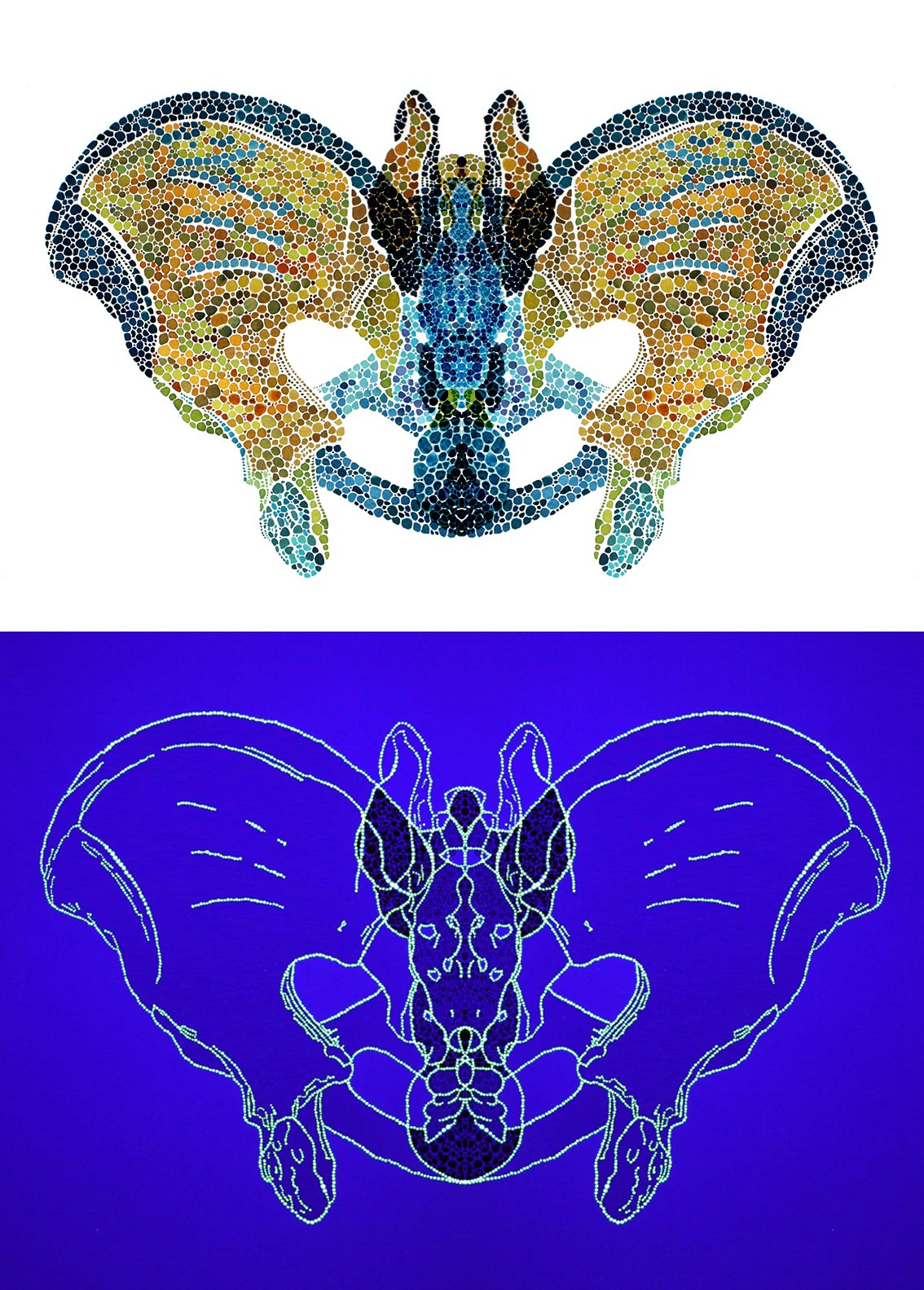«Sam a regardé le ciel pour voir s’il y avait beaucoup d’étoiles. Il semblait y avoir un nombre d’étoiles normal » Tao Lin. Vol à l‘étalage chez American Apparel.
Le ciel de Tao Lin, incroyablement vaste et pourtant morne de ces étoiles qui brillent à peine
Toute son écriture tient dans ce ciel-là, celui dont la présence menaçante et mystérieuse est réduite jusqu’au ridicule par un regard d’une ironie et d’une tristesse formidables.
Tao Lin c’est ce regard, cette ironie terrible, ces errements d’intelligences maladives dans un monde qu’elles nient. Tao Lin c’est aussi ces conversations sur Gtalk où l’on se dit bonjour quarante fois . Où l’on affirme tranquillement: « J’en ai marre de la vie » avant de se reprendre « ou attends. Je sais pas. Pas grave » (1).
Rien n’est grave tout est inconséquent, rien ne se tient, tout se vaut. Être assis ou debout c’est tout comme, être amoureux ou triste à en mourir aussi, ce qui est important par contre c’est ce que ses marionnettes mangent: « des sushis à l’avocat, du lait de coco et une barquette de fruits » (1) ou boivent: des whiskies-cola ou des vodka-raisins ou des hectolitres de café glacé .
Il semble vouloir dire un monde blanc, un purgatoire commode ou il est aussi utile de vivre que de mourir, c’est à dire où rien n’est vain puisque tout l’est.
Sa littérature est toute pleine de rues grises ou l’on marche dans une ivresse fatiguée, de regards pleins d’ironie et sans amour, de soleils épuisés et fixes qui interdisent toute ombre. Un monde sans menace évidente, sans enjeux, sans joies. De longs horizons de détente et d’anxiété succédant à de longs horizons de détente et d’anxiété.
Tao Lin écrit pour dissoudre Tao Lin semble-t-il, avec une joie contenue, qui transpire pourtant entre chaque ligne de chat Gmail: Tao Lin se sent comme une merde, Tao Lin pense beaucoup à la mort, Tao Lin prend des drogues parce qu’il s’ennuie. Tao Lin est triste comme un dimanche soir. C’est ce qu’on apprend en lisant Tao Lin, et derrière et après et pourquoi ? Rien. Tao Lin toujours, souriant, la main appliquée contre une plaque chauffante.
Un certain regard couve son monde, indifférent, amusé de tout, psychotique par endroits, il y a chez lui la nonchalance appuyée du rappeur, de l’athlète qui ralentit à quelques mètres de la ligne d’arrivée certain de sa victoire, de l’adolescent qui fume sa première cigarette, comme la frénésie grisante qu’il y a tout jeter au feu, tout, sans distinction.
« Haley Joel Osment a sorti son carnet Moleskine de sa poche et a écrit: « envoyer chèques à HSBC ». Il a écrit: « 50 pompes ». Il a remis le carnet dans sa poche et a regardé fixement devant lui. » (1)
Tout au feu, la langue d’abord, le pathos, et ce sentiment qu’un texte est écrit, le poids que peut receler une écriture aussi, ou encore cette vénération absurde du Texte.
Le Texte, ici est laminé aminci, tissé de la succession d’anecdotes, d’actes clairs et concis d’où rien ne peut s’échapper, si ce n’est leur inconséquence.
Tout au feu oui, mais pourquoi ? Parce que rien ne s’explique, rien ne fait sens, chacune des interactions qu’ont ses doubles avec le monde ou entre eux sont des énigmes en suspens, dont le mystère est le sujet même d’une poésie hésitante.
Paul se voit assis entrain de manger des chips au guacamole parce que rien n’est moins normal que d’être assis, à manger des chips, au guacamole. Sam suit ce latino taré qui marche comme un crabe dans les rues de New York, parce que si rien n’est normal, marcher comme un crabe dans les rues de New York est licite, et même beau, et même nécessaire.
Et, dans cet océan de constatations muettes et plates, de descriptions commodes et presque mécaniques, de petits cris de douleur étouffée, émerge le lyrisme le plus singulier.
Il peut sembler aventureux de qualifier de lyrique un auteur dont la prose consiste principalement en scènes du type : « Il a marché jusqu’à la cuisine, pris une boite de graines de lin bio, marché jusqu’à sa chambre, mis des graines de lin bio sur ses pâtes. » (1), quoique ces scènes ont tout de même un certain style. Mais c’est justement parce que tout ou presque chez Tao Lin est gris que le moindre éclat coloré en prend des allures monumentales.
Il est vrai que rares sont les moments où on a cette impression commune ailleurs de lire quelque chose d’écrit, mais quand ils arrivent, ces petits fragments amènent avec eux un souffle d’une douceur et d’une nostalgie extraordinaires, toute la tragédie que sous-tend la littérature de Tao Lin apparaît brièvement, avec des allures d’accident, avant de disparaître aussitôt sous des flots informes:
« ..sous une étendue uniformément nuageuse, qui brillait partout avec la même intensité et la même texture d’amiante, évoquant moins un ciel que la surface (..) d’un soleil froid, évidé, assez proche pour éclipser sa propre courbure… » (2)
Encore qu’il n’apparaissent pas à des moments clé de l’intrigue – si tant est qu’il y en ait une- ne préparent et ne présument rien, ils sont offerts gracieusement et avec maladresse, comme de gros poissons dont les écailles d’or transperceraient momentanément la surface grise d’une mare.
Ce sont les rares moments ou Tao Lin quitte son ornière pour s’approcher du monde, et tenter d’en dire autre chose que le manque, où il cède à la tentation de déclarer une préférence.
Ce n’est pas ici un lyrisme facile et inconsistant, du genre qui verrait dans ce ciel plus d’étoiles qu’on ne peut en compter, dans la lune un éclat qui ne s’y trouve probablement pas, dans le soleil un astre amical et réconfortant, mais qui tient plutôt de la profondeur inouïe que recèlent le vieux journal, les vies oubliées, les ciels noirs.
Les avatars de Tao Lin – il est difficile de les appeler sans un certain malaise personnages – souffrent, souffrent probablement, souffrent beaucoup, comme d’autres. Mais ce qui rend leur douleur si particulière, c’est qu’elle est toute entière décrite sur le mode de la dépersonnalisation.
Déchirés par l’incompréhension – mais personne ne leur demande de comprendre un Paul, un Sam un Haley Joel Osment dérivent gentiment hors de leur corps dont la souffrance leur semble trop intense pour être naturelle. Et, tandis que le monde emporté par sa course folle continue de défiler, il s’arrêtent sur le bas côté pour en contempler le flot vertigineux.
Paul, Sam, Haley Joel Osment ne souffrent pas, ne souffrent peut-être pas, ne souffrent pas beaucoup: ils se regardent souffrir.
D’où les jolies descriptions, le sentiment d’étrangeté, et ce goût affiché pour la mort. D’où ce style si particulier à Tao Lin dont les phrases monocordes portent tout de même en elles quelque chose comme l’écho d’un bruit, d’une fureur lointaine, l’intelligence inouïe de certains dialogues absurdes, la pertinence d’un regard qui voit, à défaut d’autre chose, le monde tel que le monde aura décidé de se montrer à lui.
« – Quoi, a dit Sam. Ben a répété ce qu’il avait dit.
– Quoi, a dit Sam.
– Tu as dit à Julia qu’il nous fallait plus de haricots ? A dit Ben.
Sam a songé à dire « quoi » plein d’autres fois. » (3)
C’est là l’originalité stylistique principale de Tao Lin, la clé de son humour: l’écriture dépersonnalisée, le récit objectif d’une subjectivité pathologique.
La dépersonnalisation est un syndrome psychiatrique apparaissant dans certains troubles anxieux, et qui se manifeste par un sentiment d’étrangeté à soi et au monde. Ce que le sujet dépersonnalisé fait, il ne le fait pas vraiment mais voit quelqu’un qui lui ressemble et qui pense aux mêmes choses que lui à peu près en même temps que lui, le faire.
Il est à côté, séparé du monde par un voile qui autorise l’observation mais interdit tout le reste. Comme un fusible qui saute, le patient est expulsé de lui-même, sauvé de la responsabilité terrible qu’il y aurait à répondre à de muettes interrogations.
La dépersonnalisation est, en littérature comme en psychiatrie, un symptôme, une façade, l’arbre qui cache la foret. Elle témoigne d’une souffrance qu’elle tente en se manifestant de neutraliser mais elle n’est ni en littérature ni pour le patient qui l’expérimente suffisamment consistante pour éloigner le mal, ou même le dire, elle permet tout juste de le contourner.
Paul, Sam, Haley et Tao Lin sûrement en sont l’archétype, leurs corps, les événements qui se produisent devant leurs yeux brillants, leur existence ne sont pas de leur fait, ni leur responsabilité, ce sont autant de phénomènes mystérieux et inutiles sur lesquels ils n’ont aucune prise. Ils en sont cantonnés à l’effroi, à l’observation, à l’hypertrophie phalliforme d’un regard par lequel, seul, ils sont encore aptes à saisir le monde.
Car rien après ce bidouillage qu’est la dépersonnalisation ne peut atteindre le dépersonnalisé, certainement pas l’amour, il en est réduit à l’état de corps, dont l’intelligence ralentie ne peut qu’interpréter rétrospectivement ce qui lui est donné à vivre:
« Sur le toit du quatrième étage Paul dit qu’il avait envie de courir « très vite en rond » vaguement conscient et dans l’ensemble insouciant, quand bien même il savait qu’il ne voulait pas mourir » (2)
Il y a dédoublement du vécu: d’une part le temps de l’expérience, douloureux, atrocement angoissant, incompréhensible, puis le temps de la pensée, de l’écriture, qui a pour tâche de bâtir sur des ruines, et, à défaut de faire sens, faire récit.
Les quelques hères qui hantent ses pages ne sont que des ombres, toutes tendues par la recherche de sensations, de blessures, et d’une nouveauté dont ils ne connaissent pas le nom. Ils sont jetés dans la lave avec une conscience suraiguë de leur condition, et pour seul réconfort, l’ironie.
Non pas une ironie positive qui produirait de l’humour à partir du désespoir – Bojack Horseman en est un parfait exemple- mais l’ironie négative des héros tragiques, condamnés, se sachant condamnés, n’ayant aucun moyen d’attendrir le destin, mais exécutant tout de même méthodiquement chacun des ordres absurdes qui leur sont donnés, sourire aux lèvres, dans une espèce de clair ahurissement.
Pourquoi Sam a-t-il volé une chemise chez American Apparel ?
Personne ne le sait. Pas même Sam, pas même Tao Lin, il a volé.
Mais pourquoi ?
Parce qu’on lui en a donné l’ordre, parce que le monde autour était trop méchant et muet et qu’on voulait ainsi le voir répondre quelque chose – une nuit en prison par exemple- parce que, surtout, il fallait que le silence cède la place au bruit.
Et entre ces coups d’éclats momentanés, la grisaille, toujours, des événements comme du texte, qui défilent avec une étonnante constance. Des mots qui suivent des mots qui suivent d’autres mots et l’impression dérangeante et nouvelle de lire un roman en même temps qu’il s’écrit.
Nous est offert le spectacle douloureux et insupportable d’un lent suicide qui ne s’accomplit pourtant jamais:
« Je me suis pas tailladée parce que je me détestais ou que je voulais me rappeler des trucs. Je me suis tailladée pour utiliser le sang pour dessiner ou parce que je trouvais ça joli.. » (1)
Tao Lin n’annonce pas la mort pour la faire advenir, pour le délivrer, ou tout simplement parce qu’il la craindrait, au contraire elle reste invariablement cette lumière douce et lointaine, cette possibilité ridicule avec laquelle on peut jouer à souhait, une médaille que l’on s’attache pour fanfaronner.
Bien sur il y a ces légendaires « j’ai envie de me suicider » (2), « suicidons nous » (2) qui piquent la trame grise de ses romans, mais ils ne sont jamais sérieux, comparables tout au plus aux menaces fantoches d’un enfant capricieux: «Je veux mourir » qui de sérieux n’a pas envie de mourir ? Mais mourir vraiment ? Sam, Haley Joel Osment, Paul et Tao Lin lui même ont-ils envie de mourir vraiment ?
Ses personnages ressemblent à des condamnés qui auraient oublié leur exécution imminente et parleraient de leur trépas prochain en badinant. Il n’y a là contrairement à ce que l’on pourrait supposer aucune bravoure ou lucidité seulement de l’indécision, un refus net – et que l’on peut généraliser à toute la tentative de Tao Lin – de toute responsabilité.
Il est le maitre d’un genre qui consisterait à décrire inlassablement une routine qui n’en est pas une, une vie insatisfaite, un désir monstrueux.
Ses textes s’apparentent aux monologues délirant d’âmes solitaires, qui n’entendraient, ni ne voudraient, ni ne comprendraient autre chose que leur douleur.
On répondra que toute écriture est la conséquence de l’interaction d’un monde et d’une sensibilité, de la cicatrice que celui-ci laisse sur celle-là. Que cela ne saurait suffire à le différencier. Oui, mais toute écriture ne traite pas uniquement de cette interaction, de cette cicatrice, et de ce qu’elles impliquent unilatéralement pour l’auteur.
Pourtant, aucun des romans de Tao Lin n’est écrit à la première personne du singulier, c’est qu’il y a Sam et Paul et Haley Joel Osment, et qu’ils suffisent, suffisent bien sur à porter le flambeau énorme du Je.
Il n’y a que Tao Lin dans Tao Lin, tout ce qui fait mine de s’en éloigner, de désigner autre chose, de s’oublier, n’est que tour de passe-passe, prétexte, pause entre le Je et le Je.
Tout comme Henry Miller qui, dans La crucifixion en rose s’en va de femmes en femmes, de verres – réfléchissants – en verres, de galères en galères et arrête pourtant quelques fois de manière assez touchante pour décrire la joie anonyme d’un type anonyme: un mirage bien sur, une illusion ou un mensonge pour simplets ; avant de replonger dans sa merde.
Le but premier de ces auteurs, semble-t-il, est de les faire passer du champs de leur expérience douloureuse à celui de l’Autre, du mythe, de la narration, leur victoire la plus concrète et la plus belle étant de faire du Je un Il, l’air de rien, l’air de s’excuser et de se haïr.
Ce n’est pas tant un travail qu’une supplique, adressée à tous tout le temps, et qui se justifie commodément par le nom qu’on lui donne: littérature.
On pose dans le monde son œuvre non pas car elle est utile, ou neuve, ou belle – quand bien même elle le serait- mais parce que la lire c’est dire oui à son auteur, c’est le voir tel que lui se voit et dire oui tout de même. Dire oui à sa prétendue singularité, conforter sa position supposément révoltée contre le monde, renforcer l’individu face aux communautés, aux idéologies, aux rassemblements de toutes espèces auxquels, bien sur, l’auteur n’appartient pas puisque sinon il n’aurait pas écrit.
Mais il ne réussit dans son entreprise que dans le moment où le Je est déconsidéré, réduit, disséqué méthodiquement par un légiste patient et ironique, éventuellement déguisé en Il ; c’est à dire lorsque Je prétend ne pas être lui-même ou l’être à contre-cœur, se montre du doigt en se moquant – mais se montre tout de même.
On comprend ici, le double jeu de Tao Lin, sa malhonnêteté essentielle: « oui je suis une merde, mais je viens de vous répéter mille fois peut-être que je suis une merde, sur près de cinq-cent pages, et vous lisez, c’est donc que je suis – une merde ? Rien n’est moins sur. »
Tao Lin s’interdit la poésie, du moins quand celle-ci n’est pas destinée exclusivement à pointer du doigt la tragédie du héros-auteur, sa lassitude, la méchanceté d’un monde qui ne veut pas dire oui à tout.
Il s’interdit le chant de l’autre, celui qui s’étend au delà des limites immédiates de sa peau, l’autre qui ne lui sert pas directement, qui ne pourrait en aucun cas lui rendre grâce et l’assurer de son amour.
On le voit difficilement faire l’éloge de la mer ou de la ville ou même de la mort si cette mer, cette ville, cette mort n’est pas susceptible de lui arriver, dire d’une chose qu’elle est laide ou belle ou sympathique si cette chose le dépasse et refuse de le regarder.
De manière plus générale, sa littérature peut être toute entière être comparée à un long hurlement de douleur déguisé en travail, en attitude en possible. Lorsqu’elle parle du monde elle s’applique à le nier, à en souligner l’absurdité et le silence, mais non pas dans le but de l’appeler par son nom ou même de le questionner, mais pour le réduire tout simplement.
Elle tend par la négation du monde à renforcer son auteur, par l’affirmation de son regard contre un monde transparent, justifier la vigueur de son individualité, et en route peut-être à s’attirer la sympathie d’une foule toute prête d’anxio-depressifs, anxieux et dépressifs.
Cette négation simple et nue se distingue singulièrement de tentatives antérieures dont elle semble pourtant s’être inspirée, car si l’auteur existentialiste, par exemple, nie, détruit, hurle, il s’affaire, à la fin de son oeuvre de mort à choisir pour lui-même et pour les hommes: le sens, la parole, le possible – ou du moins prend-il la peine de le prétendre.
Tao Lin quant à lui, sa tache de destruction achevée, s’en va du même pas morne et nonchalant qu’il avait en l’entamant, – s’acheter du café glacé – semble malgré les ruines qui fument derrière lui, n’avoir rien fait, n’avoir rien désiré, en somme se pare des atours de l’innocence.
Que nous dit-il de ce monde ? Des choses déjà entendues et bien connues: le vide criant d’existences comblées de confort, le néant à la fin de la course, le flottement des choses et des êtres dans un monde qui en semble désolidarisé, leur refuse toute paternité ; un éther effarant qui se refuse à la parole, aux mots, à la littérature.
En quoi consiste sa négation ? En un lent travail de purification – travail qui précède celui de l’écriture et qui s’assimile à la vie de l’auteur -, en un feu d’alchimiste suicidaire, qui écarte les impuretés, la pensée facile, et permet au dénuement véritable des choses d’apparaître avec une clarté surnaturelle.
On pourrait s’arrêter là s’il avait jamais été dit que mettre en évidence l’horreur du vide qui nous entoure est la vertu première de la littérature, peut être est-ce le cas.
On pourrait s’arrêter là et hocher de la tête Tao Lin n’était que ça.
Mais Tao Lin c’est tout ce qui n’est pas le monde puisque le monde est inconséquent, Tao Lin c’est tout ce qui reste lorsqu’il a fini de tout brûler: Tao Lin ce n’est que Tao Lin.
Lui et la cohorte dépressive et surdouée qui le précède n’annoncent plus aucune décadence imminente, ils sont la décadence, réalisent toutes les apocalypses imbéciles que l’on agite depuis des siècles, avec la nonchalance la plus absolue.
Ils ne critiquent rien puisque tout est critiquable, ne voient rien puisqu’il n’y a rien à voir, ne disent qu’eux mêmes puis vont se terrer dans des rues, des appartements, des bars aux miroirs nombreux et gris.
« Depuis que les étoiles sont tombées du ciel et que nos symboles ont pali, une vie secrète règne dans l’inconscient » écrivait Jung.
Mais ces étoiles ne sont plus simplement tombées, elles sont maintenant en «nombre normal », et cet inconscient n’est plus seulement secret, il est maintenant décrété obsolète.
Si tous les cataclysmes, les désillusions et les gueules de bois ont déjà eu lieu, que reste-t-il alors à espérer ? Que reste-t-il à craindre ?
« Rien » nous répond Tao Lin.
Le monde ?
Une ombre immense et imprécise, floue comme le jour, dont on connait si ce ne sont les raisons du moins la position relativement précise, et dont on peut dire certaines choses, vagues, futiles et pas entièrement fausses.
(1): Richard Yates. Tao Lin
(2): Taipei. Tao Lin
(3): Vol à l’étalage chez American Apparel. Tao Lin